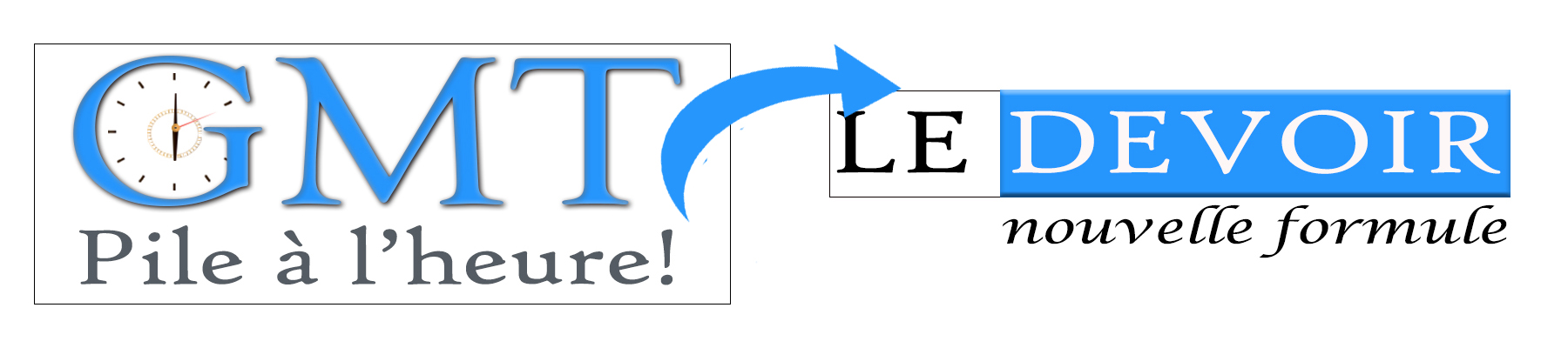Premier Ministre, un poste à géométrie variable ! Par Ousman Blondin DIOP, Ancien Coordonnateur national du Groupe de Recherches et de Réflexions (GER) du Parti socialiste (PS)
Le débat sur le rétablissement du poste de Premier ministre reprend de l’actualité et ce n’est pas un hasard. En effet, la gestion de la crise de la Covid-19, malgré une bonne prise en charge au sommet de l’Etat, a montré, dès ses débuts, quelques faiblesses de coordination et d’exécution. Auparavant déjà, certains observateurs avaient mis le doigt sur le manque de lisibilité et de hiérarchie dans l’attelage présidentiel et gouvernemental depuis la suspension/suppression du poste de Premier ministre.
Selon nous, un tel débat doit consister en une réflexion critique, mais surtout prospective, sur les avantages et inconvénients d’un rétablissement de cette fonction dans l’architecture de l’exécutif national. Mais, au préalable, un bref retour en arrière s’impose.
Le couple président de la République et président du Conseil des ministres : le modèle français de la quatrième République.
Cette formule au sommet de l’Etat, découlant directement de la Constitution de la IVème République française (1946), faisait du premier un homme aux pouvoirs limités voire honorifiques car l’essentiel des décisions politiques relevaient du Parlement et donc des partis politiques qui y étaient représentés. Ce régime parlementaire dit « régime d’Assemblée » conférait au président du Conseil des ministres, désigné par les partis politiques, une légitimité et des pouvoirs bien supérieurs à ceux du président de la République, lequel se contentait « d’inaugurer les chrysanthèmes » pour reprendre la formule imagée du Général de Gaulle !
La vie politique française sous ce régime des partis était réputée pour sa « valse » des gouvernements au gré des arrangements entre leaders des partis politiques représentés à la « Chambre des Députés », appellation d’alors du Parlement français. Et c’est précisément le Général de Gaulle qui va modifier cet ordonnancement des pouvoirs au sommet de l’Etat français, en introduisant par référendum une nouvelle Constitution en 1958 qui instaure l’élection du président de la République au suffrage universel direct. C’est l’acte majeur de cette nouvelle Constitution qui fonde la Vème République. Désormais, c’est le président de la République, élu par tous les Français, qui choisit et nomme le Premier ministre. Cela implique que le président de la République dispose d’un parti majoritaire au parlement et dans le pays pour ne pas retomber dans les affres de l’instabilité gouvernementale de la IVème République.
1. Sénégal : le binôme Senghor – Mamadou Dia : 1960-1962
Dorénavant, la source de légitimité du Premier ministre découle du président de la République, et non plus du Parlement. La vie politique française va y gagner en stabilité, et le chef de l’Etat en pouvoirs accrus, tant sur les orientations du pays que sur les actes au quotidien de la vie de la nation.
Mutatis, mutandis, en accédant à la souveraineté internationale en 1960, le Sénégal s’inspire du schéma institutionnel français, mais dans un mix qui combine celui de la IVème et de la Vème république.
Ainsi, même si Léopold Sédar Senghor est élu au suffrage universel, Mamadou Dia, numéro 2 du parti majoritaire, le Bloc démocratique sénégalais (BDS), est investi président du Conseil par l’Assemblée nationale. Mais non pas Premier ministre ! Il détient de réels pouvoirs et une légitimité qui découlent à la fois des instances du parti BDS, parti unique au pouvoir, et de la confiance du chef de l’Etat. Or, c’est le parti BDS qui a défini le programme politique et le projet de société à mettre en œuvre dans le Sénégal post-indépendant. C’est cette divergence d’interprétation entre suprématie du parti et suprématie du gouvernement qui sera à l’origine, entre autres motifs, de la crise politique de décembre 1962, entre ces deux têtes de l’exécutif, avec les conséquences que l’on sait dès les premiers pas du Sénégal indépendant.
2. Senghor 1962-1970 : un président seul aux commandes, fin du bicéphalisme et nomination d’un Premier ministre, M. Abdou Diouf.
Tirant les leçons de son épreuve de force parlementaire avec Mamadou Dia, le président Senghor concentre, entre ses mains, la totalité des pouvoirs d’Etat.
Cependant, confronté à l’évolution de la société et à la montée des revendications des paysans, des travailleurs, étudiants et forces d’opposition non autorisées, le président Senghor doit faire preuve d’autoritarisme et de fermeté pour garantir la stabilité du pays. Cette attitude répressive a un double impact : le mécontentement et la contestation s’accroissent ; et l’image du président-poète, humaniste et démocrate, en ressort ternie. C’est dans ce contexte que le président Senghor décide de modifier la Constitution et de créer un poste de Premier ministre.
Le texte qui adopte en 1970 cette nouvelle disposition constitutionnelle est très clair : il ne s’agit pas d’un chef de gouvernement-bis mais d’un « primus inter pares » c’est-à-dire le premier parmi les ministres. A égalité avec les autres, sauf dans l’ordre protocolaire.
Les hauts responsables et compagnons de lutte de Senghor ne trouvent rien à redire du choix porté sur la personne de M. Abdou Diouf qui présente le profil lisse et studieux du haut fonctionnaire apolitique. Certes, il est membre du parti au pouvoir, l’Union progressistes sénégalaise (UPS), mais n’est pas un militant actif.
A l’épreuve du temps et des crises traversées (agitation permanente des mouvements marxistes sous la houlette du Parti africain de l’Indépendance (PAI), contestation étudiante et mécontentement des syndicats des travailleurs), le président Senghor apprécie la loyauté de ce Premier ministre travailleur, discret, et surtout sa solide connaissance des dossiers de l’Etat, ce qui lui allège d’autant la tâche. Après avoir modifié la Constitution pour faire du « Premier ministre son successeur désigné en cas de démission ou d’empêchement », (Art.35), le président Senghor redonne, du même coup, un poids stratégique à cette fonction. Ainsi, après avoir occupé cette fonction dix ans d’affilée sans interruption, M. Abdou Diouf devient président de la République au lendemain de la démission du président Senghor.
3. Le président Abdou Diouf et le poste de Premier Ministre : 1981-2000.
Successeur du président Senghor dont il achève le mandat jusqu’en 1983, le président Abdou Diouf reçoit en héritage un pays en proie à de sérieux défis économiques, sociaux, financiers et politiques avec, de surcroît, une vigoureuse démocratie en marche. A la surprise générale, il choisit pour Premier ministre son condisciple et ami Habib Thiam, tombé en disgrâce depuis quelques années. Parallèlement, il s’attache les services de M. Jean Collin, ancien ministre de l’Intérieur, en qualité de ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République.
De 1981 à 1983, ce triumvirat fonctionnera tant bien que mal en raison de l’influence prépondérante du ministre d’Etat Jean Collin qui réduit considérablement la capacité d’initiative des ministres et même du Premier ministre. S’y ajoutent, en arrière-plan, les restes d’un vieux contentieux opposant Messieurs Habib Thiam et Jean Collin, qui finira par avoir raison de ce triumvirat.
C’est dans ce contexte qu’une fois élu président de la République en 1983, Abdou Diouf décide de la suppression pure et simple du poste de Premier ministre. Suppression qui lui permet de résoudre deux problèmes à la fois : lever les aspérités et frictions qui ont émaillé les deux années de collaboration peu fluide entre ses deux principaux collaborateurs, gagner en efficacité et rapidité dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au redressement de l’économie du pays dans le cadre du premier Plan de Redressement économique et Financier (PREF 1980/1985) bientôt suivi par une succession de Plans d’Ajustement structurels (PAS).
En faisant le choix de supprimer le poste de PM, le président A. Diouf fait le pari de son implication personnelle et directe en vue d’une mise en œuvre plus efficiente des mesures exigées par le redressement économique du pays.
Ce faisant, le président se retrouve seul à devoir régulièrement annoncer la liste des mesures de restrictions budgétaires ou de hausse des prix des denrées de première nécessité, ou encore de fermeture d’entreprises d’Etat, etc. Au final, l’image du président se dégrade, associée qu’elle est à celle d’un homme qui annonce les mauvaises nouvelles et semble froid et insensible au sort du petit peuple.
Cette montée en première ligne pour prendre directement les commandes des affaires du pays aura son coût politique lors des élections de 1988 qui seront très fortement contestées par l’opposition, au point de créer un climat quasi- insurrectionnel. Mais phénomène nouveau, les partis politiques traditionnels ne sont plus les seuls à occuper l’espace démocratique. Ceux-ci ont été rejoints par de nouveaux acteurs inattendus, regroupés sous le vocable de « société civile » et dont les modes d’expression et d’actions mobilisent essentiellement la jeunesse des villes (Mouvement SET/SETAL).
Au sortir de cette élection remportée par Abdou Diouf et le P.S, les débats sur les causes de cette crise post-électorale sans précédent font apparaître des courants divergents entre dirigeants historiques et « rénovateurs » pour désigner les « dioufistes ». Au terme de longues délibérations internes, il est décidé la convocation d’un Congrès extraordinaire « d’ouverture et de rénovation » pour concilier les deux courants, et surtout faire prendre au Parti socialiste un nouvel élan afin de le rendre plus attractif envers les jeunes, les cadres et la société civile naissante.
Un an après cette élection, en 1989, un conflit intercommunautaire va violemment opposer les Sénégalais établis en Mauritanie aux populations locales et déclencher, des deux côtés du fleuve Sénégal, des réactions en chaîne au point de friser un conflit armé entre les deux pays voisins. Cette crise donnera l’occasion au président Abdou Diouf de faire la preuve de son sang-froid et surtout de sa compassion à l’endroit des victimes. Son image personnelle y gagnera en sympathie populaire et en confirmation de ses capacités de chef d’Etat à tenir la barre fermement en cas de crise, au point qu’une espèce de climat de « Sainte Alliance » s’installe autour de sa personne au sein de la classe politique.
Fort de ce regain de popularité, le président Abdou Diouf lance l’audacieuse initiative de révision du code électoral tant décrié lors des manifestations post- électorales de 1988. Après son adoption par toute la classe politique, il invite son principal opposant, Abdoulaye Wade, à participer à un gouvernement de « majorité présidentielle élargie ». Ce dernier l’accepte.
Le président Diouf reste le grand gagnant de cette période qui lui permet de reconquérir une partie de l’opinion perdue lors des élections et le Sénégal regagne la confiance des institutions internationales et des investisseurs.
Cette période intense de la vie politique nationale a favorisé l’émergence d’une presse privée qui se fit l’écho de ce bouillonnement d’idées, de débats et d’animation de la vie publique qui n’épargna pas le Parti socialiste, traversé par des courants divergents entre militants « historiques » et « rénovateurs ». Sans pour autant inscrire ces courants dans les statuts du parti, le président Diouf décide de tenir un congrès extraordinaire pour rassembler les militants et attirer de jeunes cadres.
C’est précisément à ce moment-là que le groupe de réflexion du P.S, (G.E.R), fut le lanceur du débat sur le rétablissement du poste de Premier ministre, le ministre d’Etat Jean Collin étant encore en fonction. Ce dernier fit preuve d’une surprenante ouverture d’esprit à l’égard de cette prise de position, lors d’une audience accordée au responsable du GER de l’époque.
Lorsque M. Jean Collin, qualifié à juste titre d’homme fort du régime, quitte brutalement, en mars 1990, ses fonctions de ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République et, par voie de conséquence, celles de président du Comité préparatoire du futur Congrès du PS, la satisfaction est grande chez les « Barons » du P.S qui voyaient en lui la source de tous leurs malheurs.
Au sortir de ce congrès, le président Abdou Diouf rétablit le poste de Premier ministre et fait appel, pour la seconde fois, à M. Habib Thiam qui occupera la fonction d’avril 1991 à juillet 1998, en agissant comme coordonnateur de l’action gouvernementale et bouclier politique du Président Abdou Diouf face aux partis d’opposition, y compris durant l’épisode de participation de certains d’entre eux au gouvernement de « majorité présidentielle élargie ». Lui succédera à la Primature M. Mamadou Lamine Loum, ancien ministre du Budget, un technocrate, qui assumera cette fonction tout au long des Plans d’Ajustement à moyen et long terme (P.A.M.L) et aura surtout la lourde tâche d’adapter l’économie et le pays aux multiples effets de la dévaluation du FCFA intervenue en 1994.
4. Abdoulaye Wade et ses premiers ministres successifs : 2000-2012.
Leader historique de l’opposition sénégalaise depuis l’ouverture démocratique de 1974, maître Abdoulaye Wade est élu président de la République en février 2000.
Durant ses 12 ans de présidence, il s’attachera les services des six premiers ministres suivants : Moustapha Niasse, Mme Mame Madior Boye, Idrissa Seck, Macky Sall, Cheikh Hadjibou Soumaré et Souleymane Ndéné Ndiaye, les records de longévité étant détenus par MM. Macky Sall et Souleymane Ndéné Ndiaye (trois ans chacun).
Il est encore difficile de dire aujourd’hui avec précision quelle conception le président Wade se faisait de la fonction de Premier ministre, l’étendue de son pouvoir présidentiel laissant très peu de marge de décision à ses ministres et à son administration. Une explication est cependant possible : le président Wade est réputé pour son penchant prononcé pour le modèle exécutif anglo-saxon de type américain, c’est à dire celui d’un « hyper présidentialisme » mais sans contre-pouvoirs. Or, appliquée à un petit pays africain tel que le Sénégal, cette conception a inévitablement conduit le président Wade à diriger presque personnellement l’ensemble des ministères, au grand dam de l’Administration.
5. Macky Sall : 2012-2019
Durant son premier mandat de 7 ans, le président Macky Sall a fait appel à trois premiers ministres : M. Abdoul Mbaye, Mme Aminata Touré et M. Mahammad Boun Abdallah Dionne, qui détient le record de longévité depuis l’an 2000 pour avoir occupé cette fonction durant cinq ans.
A l’issue de sa réélection, le Président Macky Sall a procédé à la suppression/suspension (?) du poste de Premier ministre. Cette mesure consacre à nouveau un présidentialisme renforcé du régime qui peut se justifier par les urgences dictées par la crise sanitaire et le souci d’accélérer les réalisations promises au pays. Toutefois, cela ne doit pas se traduire par des entorses et des dérogations par trop excessives au regard des procédures existantes, ce qui pourrait autoriser d’autres abus dans l’ensemble de l’Administration.
En vérité, le débat pourrait se résumer entre une approche fonctionnaliste et une autre plus politico-personnelle qui privilégie la personne avant l’institution. A cet égard, il est certain que les présidents Senghor et Diouf étaient acquis à l’idée d’incruster progressivement la culture de la déconcentration à tous les échelons de l’Administration. En revanche, la conception des présidents Wade et Sall semble s’apparenter à une valse-hésitation entre « fusible » et « dauphin putatif », oubliant de fait la fonction initiale de tout Premier ministre, à savoir, celle de coordonnateur de l’action gouvernementale. Or, la gouvernance moderne, devenant de plus en plus complexe, requiert précisément collégialité, partage des rôles, et délibération avant toute décision majeure.
De toute évidence, cette longue trajectoire à géométrie variable de la fonction de Premier ministre nous raconte autant la vie politique que la vie institutionnelle de notre pays. A ce titre, elle doit pouvoir faire débat utilement.
Aujourd’hui, alors même que notre pays, à l’instar de beaucoup d’autres en Afrique et dans le monde, va devoir se préparer à l’émergence du nouveau monde qui résultera inévitablement des conséquences systémiques de la crise du Covid-19, la problématique du rétablissement de la fonction de Premier ministre mériterait d’être inscrite à l’ordre du jour des travaux du Comité en charge du Dialogue National. Il serait dommage de manquer une telle opportunité.
Pour notre part, notre opinion est que la fonction présidentielle doit rester de conception, d’impulsion, d’orientation, d’innovation et surtout de contrôle, avec le soutien d’un premier ministre « apolitique » qui se consacre exclusivement, dans le contexte actuel, à adapter le pays aux nouvelles priorités d’ordre sanitaire, alimentaire, budgétaire, etc., le tout dans une démarche rigoureuse et transparente.

[sdm_download id=”3642″ fancy=”0″]