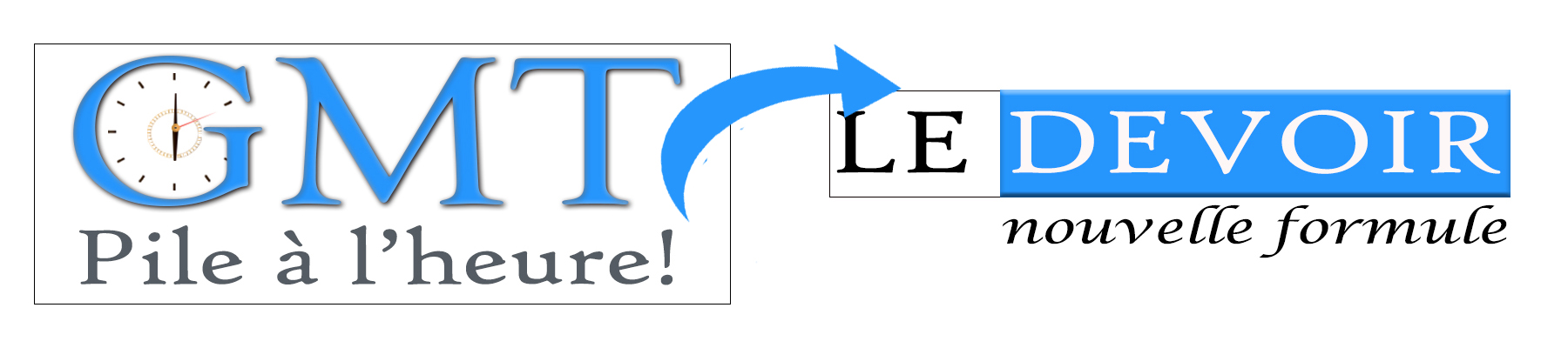Coin d’Histoire – Georges Marchais, ancien Secrétaire général du Parti communiste français Par Mohamed Bachir DIOP
La postérité retiendra de lui son sens de la répartie et son génie politique
Georges Marchais est né le 7 juin 1920 dans une localité du Calvados en France dénommée La Hoguette. Fils d’ouvrier et ouvrier lui-même, il sera d’abord un syndicaliste remarquable avant de rejoindre le Parti communiste français où il gravira rapidement les échelons. Mais il sera quelque peu dénigré par ses adversaires, même au sein du PCF car on lui reprochera de n’avoir pas participé activement à la libération de la France sous occupation allemande et de s’être réfugié en Allemagne justement pour ne pas participer activement à la résistance.

Avant l’invasion allemande en mai 1940, Georges Marchais, âgé de vingt ans, était déjà mécanicien ajusteur à l’usine aéronautique « Voisin » d’Issy-les-Moulineaux. Lors de l’Occupation, les usines aéronautiques de la région parisienne sont réquisitionnées par les Allemands pour produire notamment des avions de chasse Messerschmitt et pour la réparation d’avions endommagés. Dès le début de 1941, la production commence. En décembre 1942, sur le conseil de ses mandants qui avaient donné un avis favorable à son embauche chez « Voisin », Georges Marchais est muté par l’entreprise pour travailler au sein de la société Messerschmitt à Augsbourg en Allemagne et y recueillir des informations.
Pour se défendre, Marchais affirme avoir été victime du service du travail obligatoire (STO) et déclare être rentré en France dans les premiers mois de 1943. Mais la date de son retour définitif en France est sujette à controverse : il n’est pas établi s’il est retourné en Allemagne ou s’il s’est caché avec sa femme et sa fille jusqu’à la Libération. Au début des années 1970 et surtout à la veille de l’élection présidentielle de 1981, dans le cadre de révélations du journal « L’Express », ses adversaires politiques l’accusent d’être parti travailler en Allemagne « volontairement ». Le communiste Charles Tillon lui reproche également de ne pas avoir quitté la France durant la guerre.
Selon l’historien français Philippe Robrieux, cette attitude qualifiée de « non résistante » (comme celle de Maurice Thorez qui était alors le patron du PCF) fera plus tard de Marchais un militant soumis aux ordres des dirigeants soviétiques qui possèdent son dossier biographique. Situation qui conduira après-guerre à la marginalisation des grands résistants au sein du PCF et favorisera l’ascension de Georges Marchais.
Un autre historien, Bruno Fuligni indique que Georges Marchais ne participe pas à la résistance armée après son retour d’Allemagne mais distribue des tracts dénonçant l’occupation. Polémique inutile entretenue par ses adversaires politiques et qui ne l’empêcheront guère de diriger le PCF comme inamovible Secrétaire général de 1972 à 1994 ni d’être élu député de 1973 à 1997 et député européen de 1979 à 1989.
Marchais commence d’abord par être le Secrétaire du syndicat des métaux d’Issy-les-Moulineaux. Il est ensuite Secrétaire du centre intersyndical CGT dans la même commune, en 1951, et Secrétaire de l’Union des syndicats de travailleurs de la métallurgie de la Seine de 1953 à 1956.
Membre du Parti communiste français (PCF) à partir de 1947, il connaît une ascension rapide au sein du parti, sans jamais avoir eu l’occasion de participer ni de s’exposer lors des événements fondateurs de la geste communiste antérieure à 1945.
D’abord permanent de la CGT, il intègre l’équipe de direction de la puissante fédération Seine-Sud du PCF (celle du secrétaire général, Maurice Thorez) dans le cours de l’année 1955. À l’issue du congrès de 1956, il devient membre suppléant du Comité central du PCF et Premier secrétaire de la Fédération de la Seine-Sud, puis en 1959 membre titulaire du Comité central et du Bureau politique.
Son ascension s’inscrit dans un contexte marqué par des remous en interne consécutifs à la publication du rapport Khrouchtchev, que Maurice Thorez tente de mettre sous le boisseau. De plus, le PCF enregistre un déclin de ses effectifs comme de son audience électorale (il passe sous la barre des 20 % aux élections législatives françaises de 1958 et, à la suite de la modification du mode de scrutin, ne fait élire que 10 députés). Se sentant menacé, Maurice Thorez entreprend d’écarter certains des dirigeants du parti qu’il soupçonne de vouloir s’appuyer sur le leader soviétique pour l’évincer. Bénéficiant de sa fidélité à Maurice Thorez et de son statut d’ouvrier, Marchais fait alors partie des étoiles montantes du parti.
En 1961, il succède à Marcel Servin au poste stratégique de Secrétaire à l’organisation. Dans cette fonction, le principal objectif de Georges Marchais est de faire repartir à la hausse les effectifs.
Responsable encore peu connu à l’extérieur du parti, il se fait remarquer pendant Mai 1968 par un article paru dans « L’Humanité » où il attaque frontalement Daniel Cohn-Bendit, leader charismatique du mouvement qu’il qualifie d’« anarchiste allemand », formule qui vise pour le PCF à contester la légitimité de la révolte étudiante en s’en prenant au « parti de l’étranger ». Il critique les « faux révolutionnaires » du Mouvement du 22 Mars, dont l’« agitation », selon ses termes, « va à l’encontre des intérêts de la masse des étudiants et favorise les provocations fascistes ». Cependant, face à la répression policière, Georges Marchais et le PCF soutiennent le mouvement étudiant et ses revendications. Ils appellent à l’union des étudiants et des ouvriers, et à la création d’une « université moderne et démocratique qui doit remplacer l’université de classe actuelle ».
En juin 1969, il fait partie de la délégation du PCF lors de la conférence du Mouvement communiste international organisée à Moscou. Elle revient en France sans Waldeck Rochet, dont l’état de santé s’est détérioré. De fait, c’est Georges Marchais qui prend progressivement les rênes du PCF, devenant secrétaire général adjoint en 1970. C’est à ce titre qu’il conduit la délégation communiste lors des négociations préalables à la conclusion du Programme commun de gouvernement avec le PS et le Mouvement de la gauche radicale-socialiste en juin 1972.
En décembre 1972, il devient Secrétaire général du PCF, succédant à Waldeck Rochet qui démissionne pour raisons de santé. Élu député après le redécoupage électoral de 1988, il est constamment réélu jusqu’en 1997.
La première phase de son passage à la tête du PCF est marquée par une continuité avec la politique de son prédécesseur : l’Union de la gauche au plan national (ainsi le PCF soutient la candidature de François Mitterrand dès le premier tour de l’élection présidentielle de 1974) et la poursuite d’une certaine prise de distance avec l’Union soviétique. Il participe à la constitution d’un pôle eurocommuniste avec notamment le Parti communiste italien d’Enrico Berlinguer et le Parti communiste espagnol de Santiago Carrillo.
Lors du congrès de 1976, le PCF renonce à la dictature du prolétariat. Néanmoins, la croissance des effectifs procure peu de gains électoraux et le PCF, premier parti de gauche depuis la Seconde Guerre mondiale, tend à être rattrapé par le PS. En septembre 1977, les négociations en vue de la réactualisation du Programme commun échouent, annonçant la défaite de la gauche lors des élections législatives de 1978. Il s’ensuit une vague de contestation dans une frange du parti (notamment du côté des intellectuels). Il est reproché à Matchais d’être, par son changement de ligne politique, en partie responsable de cet échec.
Dans un article de L’Humanité du 13 février 1979, préparatoire au XXIIIe congrès du parti, il évoque le « bilan globalement positif en URSS », ce qui provoque une vive polémique en France. Trois ans plus tôt, le parti avait pourtant renoncé à toute référence au modèle soviétique, à la dictature du prolétariat, pour adopter des thèses proches de celles du parti communiste italien, dans la ligne de l’« euro-communisme ». En décembre 1979, le soutien public de Georges Marchais à l’intervention soviétique en Afghanistan (prise de position contraire aux orientations prises par le comité central du PCF) est interprété comme le signe d’un réalignement du PCF sur la politique des dirigeants soviétiques.
Tête de la liste du PCF aux élections européennes de 1979, il obtient 20,6 % des voix et envoie 19 députés PCF au Parlement européen, il est élu député européen et le reste jusqu’en 1989.
Candidat communiste à l’élection présidentielle de 1981, il ne peut parvenir à obtenir que 15,35 % des voix, un score historiquement faible et inférieur à ce que les sondages annonçaient. Ce résultat confirme le déclin de son parti au profit du Parti socialiste, François Mitterrand recueillant 25,85. Entre les deux tours, il soutient la position officielle du PCF soutenant ce dernier en vue du second tour.
Après l’élection de François Mitterrand et les élections législatives anticipées de 1981, le PCF entre au gouvernement en obtenant quatre ministères.
De nouveau candidat aux élections européennes de 1984, Georges Marchais ne réalise que 11,20 % des suffrages et ne distance le Front national de Le Pen que de 0,25 point. Son parti passe ensuite très vite sous la barre des 10 % et se fait distancer par le Front national, à l’élection présidentielle de 1988. Le déclin du parti s’accélère à la suite de la dissolution de l’URSS, en 1991.
Lors du XXVIIIe congrès du PCF, en janvier 1994, Georges Marchais, contesté en interne et affaibli par des problèmes de santé, cède son siège de secrétaire général à Robert Hue tout en restant membre titulaire du bureau politique (renommé bureau national). La même année, il devient président du comité du PCF pour la défense des libertés et droits de l’homme en France et dans le monde. En 1996, il quitte le bureau national mais est réélu au comité national. Il quitte l’Assemblée nationale après avoir décidé de ne pas briguer un nouveau mandat de député aux élections législatives de 1997.
Fragile du cœur (il a subi des infarctus en 1975 et 1989-1990 et s’est vu poser un stimulateur cardiaque en 1996), il meurt des suites d’un malaise cardiaque, le 16 novembre 1997, à l’hôpital Lariboisière.