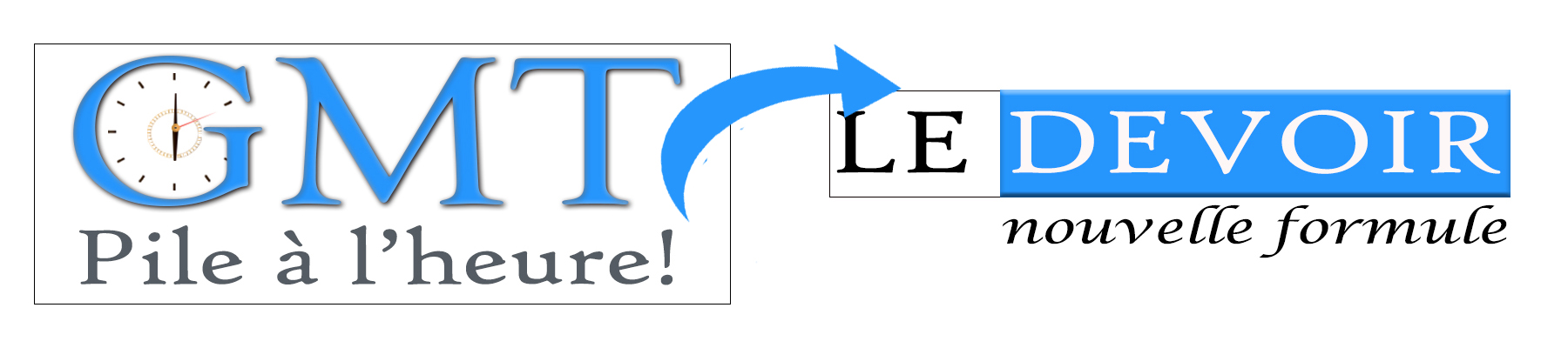Passé-présent: Marseille noire, années 20. De la musique, des filles qu’on paye et des marins africains avec ou sans pieds Par Chloé LEPRINCE
À Marseille, l’histoire du port et des quartiers populaires est aussi une histoire noire. Méconnue. Mais mieux connue grâce à un écrivain du nom de Claude McKay.
Claude McKay, né en Jamaïque et naturalisé américain, sera marxiste de Harlem à Marseille avant de devenir un écrivain catholique sur le tard.
“Nos touristes peuvent-ils rêver quelque chose de plus captivant que ce “plein air marseillais” où se mêlent- toujours sous le contrôle de l’Administration – la Vie familiale, le souci de l’Hygiène, l’Orientalisme le plus pur et la Grâce française la plus spirituelle ?”
Cette publicité pour les maisons closes du “quartier réservé” à Marseille, entre-deux guerres, porte la trace d’un monde de nuit, d’aventure et de mélanges. Un monde d’il y a un siècle, qui n’existe plus. Un monde enseveli sous les gravats en janvier 1943, le temps d’une co-production macabre entre les autorités françaises, sous le haut patronage de René Bousquet, et les troupes nazies qui occupaient la ville portuaire depuis la fin de l’automne 1942. Après une rafle, on fit dynamiter ce jour-là à l’explosif ce vieux quartier marseillais qu’on appelait “La Fosse”.
Le 23 janvier 1943, se dérobait dans les éboulis un entrelacs de ruelles dévalant des hauts du Panier jusqu’aux quais du Vieux-Port. Une éclipse de gravats et de fumée, juste derrière l’Hôtel de ville et à deux pas de la rue de la République et de ses façades ouvragées aux reliefs de la mer. Longtemps, on dira encore “rue impériale” de cette artère haussmannienne percée au milieu du XIXe siècle pour relier ce coin populaire au port de la Joliette, tout juste sorti des rives d’une Méditerranée industrieuse : à Marseille, du temps de l’essor industriel, la géographie urbaine embarquait autant de promesses de travail et d’habitudes du petit ordinaire que d’histoires transnationales. Des histoires qui croisaient les mers en même temps qu’elles racontaient des façons de faire une vie quand on n’était pas d’ici.
Rafle à Marseille en 1943 : un quartier rasé et le petit rire de Pétain
Le meilleur chemin pour plonger dans ce monde méconnu est encore de lire des livres. L’aventure “captivante” que vantait le prospectus pour les maisons de passe du Vieux-Port se déploie par exemple sous la plume de Pierre Mac Orlan. Après avoir fait un séjour à Marseille, l’auteur de Quartier réservé décrira cet “équilibre de paix, fétide mais acceptable” d’un quartier de pègre, de sexe et aussi de gens simplement modestes. Un lopin dans la ville qu’on dorlote, qu’on surveille et qu’on mate tout à la fois, car c’est bien sous les auspices accommodants de la municipalité et de la préfecture que ces ruelles qui se jetaient dans le bassin du Vieux-Port avaient été dédiées à la prostitution : sur la rive d’en face, on cherchait alors à nettoyer les environs de la Bourse. Mais de ce “Petit Naples”, on parlera aussi comme d’un “Harlem miniature” – les immeubles bourgeois des brownstones harlémites en moins, et le Mistral qui rend fou, en plus. Et alors c’est un autre auteur qu’il faut suivre entre les livres pour y pénétrer : Claude McKay, né en Jamaïque en 1889 avant de se faire naturaliser américain, incarner en littérature l’affirmation d’une souveraineté afro-américaine… et finalement publier le livre qui deviendra le tout premier best seller jamais écrit par un écrivain noir, Home to Harlem.
Quand Home to Harlem paraît en 1928 aux Etats-Unis, McKay achève tout juste une boucle qui tient ensemble quantité d’histoires de New-York jusqu’à Tanger. En passant par Marseille. Parce qu’il a séjourné dans la ville portuaire en 1927 et en a fait des livres, c’est à lui, l’auteur de passage et ses lunettes d’importation, plus qu’à un autre, qu’on doit de connaître l’histoire de Marseille noire. Celle de la nuit son et lumière, celle de marins africains et de prostituées d’ici ou d’ailleurs : un petit monde déviant en somme, ou un monde de la petite déviance, selon. Autant de trajectoires un peu boiteuses que McKay mêle au bord du quai à des vies de peu, les bas-fonds qui croisent l’ordinaire d’un petit sillage populaire.
Nancy Cunard, Langston Hughes et la Harlem Renaissance
Car Marseille, au début du XXe siècle, est aussi cette cosse noire qu’on ne connaîtrait pas si bien sans Claude McKay. Parce que le romancier avait attrapé quelque chose de cette histoire qui échappe souvent au plus près des archives, McKay est cité dans tous les travaux sur l’histoire portuaire et populaire de la ville dans les années 20. Bon nombre des pêcheurs, dockers, manutentionnaires qui trouvaient à se faire embaucher au port étaient souvent Italiens, et parfois Espagnols ou Maltais. Mais dans ce quartier marseillais de “La Fosse” vivait aussi une communauté africaine importante. Des marins noirs se mélangeaient là avec des musiciens de jazz, des filles qui faisaient payer la peau, ou leurs souteneurs. Et parfois, le marin était musicien et lui-même un peu maquereau : alors que Marseille grossit de 100.000 habitants à la sortie de la Première Guerre mondiale et compte déjà 700.000 habitants, le trafic explose et les illégalismes en tous genres tissent leur toile de part et d’autre des quais du Vieux-Port, après la Grande guerre. Une vie de nuit sans lune, éclairée à la lueur des troquets, des bouges, des forfaitures et des sales coups.
La vision qu’on en a a aussi quelque chose de cinématographique parce que c’est encore la fiction qui documente le mieux ce monde-là. Dans ce quadrilatère bien bordé par les autorités où s’entortillent intrigues de bas-fonds et menu fretin, les personnages de McKay se détachent souvent comme se déploieraient les solos d’une bande originale : la littérature de McKay est une écriture sonore, qui mêle du jazz et un blues un peu râpeux aux bruits du quartier populaire. On y entend moins les drisses des voiliers que les poulies d’un port ouvrier. Car l’auteur américain, qui a choisi Marseille et non Paris pour installer ses livres de France, est un écrivain du prolétariat. Un marxiste, qui a lu le grand intellectuel panafricaniste W.E.B. Dubois (premier Noir à soutenir un doctorat à Harvard) et assisté au quatrième congrès de l’Internationale socialiste en Russie soviétique. Une figure du mouvement Harlem Renaissance qui a éclot au mitan des années 20. Un écrivain qui restera d’abord comme l’auteur de livres qui racontent, depuis les marges, une histoire marxiste des Noirs. Parce que la littérature de McKay est une écriture du peuple en plus d’une écriture de la négritude, ce sont, en filigrane, des récits galonnés par l’idée d’une solidarité qui fait parachute dans les filets de la relégation.
Le “problème des Blancs avec les Noirs”, à propos de W.E.B. Du Bois
À Marseille, c’est ainsi en nouant la race et la classe que McKay met en lumière la part africaine du port marseillais. C’est cette histoire méconnue qu’on voyait se déployer dans Banjo, son grand roman marseillais de 1928 dont Dubois, justement, dira :
« Banjo n’est pas un roman, c’est une sorte de philosophie internationale de la race noire ».
Et c’est avec ce fil qu’on renoue maintenant que paraît, ce mois de juin 2021, « Romance in Marseille », un roman inédit qui a récemment été publié aux Etats-Unis et voit finalement le jour en français (chez Héliotropismes, éditeur artisanal marseillais), plus de 70 ans après la mort de McKay. Au gré d’une aventure éditoriale à rebondissements que vous pourrez découvrir en lisant par exemple Gilles Rof, le correspondant du Monde à Marseille.
« Romance in Marseille » est bien un roman du mouvement Harlem Renaissance. Pas seulement parce que Claude McKay fut une figure tutélaire de ce mouvement qui faillit s’appeler le mouvement “New Negro” et qui, depuis les arts, affirmera dans les années 1920 quelque chose d’une autonomie, d’une souveraineté, d’une histoire et d’une fierté noires. « Romance in Marseille » est aussi un roman de la Harlem Renaissance sur son flanc industrieux, parce que son personnage principal, Lafala, docker africain estropié, se redresse une fois envolé l’usage de ses pieds.
Ce héros aux pieds coupés campe ce petit monde bancal qui plonge et relève la tête. Un univers de déveine, de coups du sort et de démerde où, les deux pieds devant mais bien vivant, un héros improbable grimacerait “Même pas mort !” Démasqué alors qu’il avait embarqué clandestinement à bord d’un paquebot après avoir été plumé par une prostituée belle et orientale, Lafala a passé toute la traversée enfermé dans les toilettes du navire de la compagnie Fabre. A l’époque un épicentre du trafic transatlantique, à Marseille. Ses pieds, qui ont gelé, n’y survivront pas. Et voilà Lafala amputé, et cette société emblématique du commerce maritime marseillais au début du XXe siècle, embarquée dans une histoire d’indemnisation de part et de d’autre de l’Atlantique, tandis que le héros se refait une santé éclopée du côté de Harlem. La prothèse est aussi métaphorique, et le retour de Lafala du côté du Vieux-Port n’est pas tout à fait un retour à la case départ. Le sort est bancal, les jambes ne dansent plus le tango mais le héros indemnisé tient debout. Sous la plume de Claude McKay, l’ébène est vertical même quand ça penche.
Se faire passer pour un Blanc : histoires de supercheries.Nigérian aux pieds estropiés
Lafala, le docker de « Romance in Marseille », est né en Afrique de l’Ouest. Mais le récit de McKay est inspiré d’une histoire vraie. Tandis qu’il séjournait à Marseille, l’écrivain avait découvert ce fait divers, qui faisait alors bien des remous dans la communauté noire établie là. Et dont on croise encore la trace dans les archives de l’époque. En 1927, écumer le quartier noir des Africains et des Antillais, c’était forcément être traversé par l’histoire folle de ce Nigérian clandestin qui avait perdu l’usage de ses pieds à bord d’un bateau Fabre. Puis entrepris, notamment grâce à McKay en personne, des démarches pour se rembourser d’une vie les jambes en moins.
Dans « Romance in Marseille, », Lafala était docker avant de perdre ses pieds. Dans la vie aussi, Nelson Simeon Dede avait été docker, et marin. Car à Marseille, après la Grande Guerre, on comptait de nombreux marins africains qui travaillaient au port, comme dockers et manutentionnaires. Un déclassement qui forcément avait un coût symbolique. Mais qui signifiait, aussi : rester à portée de rivage, donc de quoi conserver un peu du prestige du métier de navigateur. Un pied dans le monde de la mer, et de quoi manger à terre malgré tout. Les places pour embarquer étaient en effet devenues chères, à la sortie de la Grande Guerre, à mesure que le nombre de candidats augmentait. Parmi eux, beaucoup de ceux qu’on appelait les “tirailleurs”, qui avaient d’abord été mobilisés en Provence, où l’armée française avait établi des camps d’entraînement pour soldats de l’empire. Puis démobilisés. S’égaillant là à s’installer pour rester, ils grossirent les rangs de la communauté noire marseillaise après l’armistice. Mais ils n’étaient pas les premiers à composer une histoire maritime noire qui en fait les précédait.
La première trace d’un marin noir à Marseille remonterait à 1848, mais c’est surtout au tout début du XXe siècle que l’histoire du port de Marseille devient aussi celle de ces marins africains venus s’établir là. Au point qu’en 1912, le Conseil d’Etat autorisera explicitement en toutes lettres les compagnies maritimes à employer un certain pourcentage de marins coloniaux dans leur équipage. À l’orée du XXe siècle s’étaient ainsi établis à Marseille des navigateurs noirs issus des grands ports de l’empire français ou du commerce fluvial : “Ces marins caboteurs se transformèrent en navigateurs au long cours quand les compagnies maritimes commencèrent à desservir régulièrement la côte occidentale d’Afrique”, écrivent les sociologues Brigitte Bertoncello et Sylvie Brédeloup qui ont consacré de beaux travaux à l’histoire maritime africaine de Marseille. Citant McKay à l’occasion, les deux chercheuses remontent le fil de cette présence marseillaise en excavant autant de récits pionniers, qui souvent s’achèvent sur une reconversion comme restaurateur. Elles expliquent notamment que c’est après la création du port international de commerce de Dakar, en 1907, que toute une catégorie de navigateurs africains trouvera de quoi refaire son prestige largement entamé par le déclin du commerce fluvial. À mesure que les compagnies maritimes de la puissance coloniale (dont Fabre, justement) augmenteront les rotations pour desservir la côte ouest du continent africain, ce seront autant de possibilités de reclassement qui s’ouvriront pour des matelots issus de lignées spécialisées dans le commerce de gomme arabique et de kola sur les fleuves Sénégal, Casamance et Gambie… et parfois, avant eux, la traite d’esclaves.
D’Afrique de l’Ouest et de Madagascar
Parce que Claude McKay pose sur ce centre-ville populaire son regard d’écrivain attentif au sort des Noirs, c’est à toute une présence africaine maritime qu’il nous négocie un accès sensible, à un siècle de distance. Du quai aux dédales étroits du quartier où certaines trouées comptaient treize maisons closes pour quatorze immeubles et un chapelet de troquets où l’on buvait d’abord entre Djiboutiens, entre Sénégalais, ou entre Guinéens, l’histoire du port de Marseille et de son “quartier réservé” est aussi celle de gens de la mer arrivés là dans les ressacs d’une histoire coloniale. La plupart venaient d’Afrique de l’Ouest, beaucoup plus rarement des côtes levantines du continent, mais souvent, aussi, de Madagascar : cherchant à faire des comptages dans cette histoire assourdie, l’historien Philippe Dewitte a exhumé un recensement du Ministère des Colonies en 1926, qui montre que 800 navigateurs africains étaient regroupés à Marseille et Bordeaux. La moitié seulement étaient originaires d’Afrique occidentale française, et 300 venaient de Madagascar.
Héritiers de cette histoire-là, les marins qui viendront gonfler les vieux quartiers du port à l’issue de la Grande Guerre réclameront à leur tour des quotas, et, dans les années 1920, une “Amicale” des marins africains qui voit le jour, et qui œuvre en lien avec le syndicat des marins à Dakar, tandis qu’en 1926, se crée à Marseille une section locale du Comité de défense de la race noire. Mais elle aura la vie courte, comme le raconte l’historien Sylvain Pattieu dans un article passionnant sur les souteneurs noirs du port phocéen : s’implanter dans le paysage militant marseillais n’était pas aisé pour les noirs dans l’entre-deux guerres.
C’est cette histoire d’un petit ordinaire prolétaire d’ici et d’ailleurs à laquelle nous mène McKay sur les quais de ce port hexagonal qu’on appelle “la porte de l’Afrique”. L’expression, qui a survécu jusqu’à aujourd’hui dans la deuxième ville de France, charrie plutôt des images d’Afrique du Nord, à vrai dire. Mais l’œuvre de McKay nous guide justement jusqu’à un récit moins connu, qui dessine un arc de cercle, comme un pont entre l’Afrique noire, ce port d’un empire colonial sur la Méditerranée, la Caraïbe et la côte Est des Etats-Unis. C’est là, à un jet de pierre des gratte-ciels de New York, qu’accoste Lafala, le héros de « Romance in Marseille ». Là aussi que s’édifiait la Harlem Renaissance au moment où McKay peaufinait son roman depuis le Maroc.
En posant ses valises à Marseille plutôt qu’à Paris, McKay chemine lui-même du côté des contre-allées de sa propre histoire culturelle et politique. Dans les années 20 et 30, la capitale française était en effet un épicentre de rencontres transnationales qui se tissaient autour de la condition noire. Et les lettrés afro-américains qui dialoguent avec le petit monde des lettres français se croisent à Paris plutôt qu’à Marseille ou Tanger. C’est là par exemple, qu’ils découvrent l’Anthologie nègre que Blaise Cendrars vient de faire paraître et autour de laquelle un dialogue s’est noué. Intellectuel qui a conceptualisé les ressorts théoriques de la Harlem Renaissance et mécène afro-américain, Adam Locke, dans un texte aux allures de manifeste, reconnaîtra par exemple, six éditions plus tard, la quête d’une inspiration qui puiserait au creuset de sources africaines comme autant de traces d’une essence noire. Folkorique et essentialisant ? De l’autre côté de l’Atlantique, les intellectuels de la Harlem Renaissance, à leur tour aussi et depuis leur position, chercheront ce que peut être au fond un “tempérament noir” ou un “tempérament nègre”.
McKay n’est pas étranger à cette quête-là. Lui qui avait gagné New-York alors que ses poèmes avaient déjà commencé d’être publiés dans sa Jamaïque natale est une des grandes signatures de la Harlem renaissance – si canonique, même que certains disent, son prophète. Mais lui moissonne du côté de Marseille, une négritude peut-être un peu rugueuse – et aussi plus destroy. Il glane des récits fracassés et une poignée de destins cabossés là où, à Paris, les intellectuels noirs qui voyagent rencontrent des militants africains, des intellectuels, des partisans précoces de l’indépendance, des adhérents du parti communiste français. À l’époque, le PCF grossit volontiers ses rangs de militants coloniaux et c’est dix ans plus tard qu’Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas ou Léopold Sedar Senghor forgeront la “négritude”. L’histoire du mouvement Harlem Renaissance est aussi celle d’une rencontre entre deux élites qui franchissent la ligne de couleur. Y compris de part et d’autre de l’Atlantique. À W.E.B. Dubois dont toute l’œuvre (récemment traduite et formidablement rééditée par Nicolas Martin Breteau à La Découverte) consistera à déconstruire l’idée d’un “problème noir” et qui dira si bien comme “être un problème est une expérience étrange”, la littérature de McKay semble répondre en sautant d’un pied sur l’autre le temps d’une fantaisie nocturne. Et bancale.
—-
Source:
France Culture